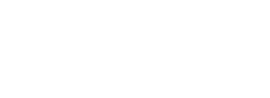Guerre du Bani-Volta - conférence de Thomas Vennes
La guerre du Bani-Volta (1915-1916) : compte-rendu de la conférence de Thomas Vennes
Par Guillaume Bouchard Labonté, 29 juin 2020
La France a justifié l’expansion de son « deuxième Empire colonial », dès la deuxième moitié du XIXe siècle, par sa mission « civilisatrice ». Construction d’écoles, d’infrastructures, remplacement d’un gouvernement « oppresseur et esclavagiste » par un État moderne… mais la réalité, explique Thomas Vennes, est très éloignée de la propagande.
Sous la Troisième République, l’État français prétend construire un Empire universaliste et républicain. Dans les faits, elle exporte un « progrès au bout de la baïonnette » dans le cadre de conquêtes violentes et brutales. Le partage de l’Afrique, négocié lors de la Conférence de Berlin de 1884-1885, lui donne toute la légitimité nécessaire à la revendication de territoires jusque-là relativement épargnés par la colonisation. Occuper ces régions, surtout à l’intérieur des terres, n’est cela dit pas une mince affaire. Les habitants locaux possèdent déjà leurs propres structures sociales, gouvernements et aspirations.
Les colonies doivent de plus lever des impôts et des troupes : c’est la source de beaucoup d’instabilité. La « pacification » des zones les plus réfractaires, par l’armée coloniale, est une aventure sanglante.
En 1915, la France manque cruellement d’hommes. Ses quarante millions d’habitants ne font pas le poids face aux soixante millions d’Allemands. Recruter dans ses colonies devient pour elle une nécessité. Mais une bonne partie des populations visées, ni cooptées ni soumises, résistent parfois à ces départs souvent forcés des hommes de leur communauté. Dans les villages, les stratégies d’évitement se multiplient ; beaucoup de jeunes déserteurs sont traqués et tués. Les habitants sont choqués : ce recrutement qui a des airs de kidnapping leur rappelle le système esclavagiste. Dans le Bani-Volta, situé dans l’actuel Burkina Faso, la population locale y est particulièrement opposée. On tient alors, en 1915, une assemblée à Bona pour débattre de la question. C’est cette réunion de divers villages qui mène à l’organisation d’une révolte anticoloniale massive.
Dans les mois suivants, la France mène une série d’opérations, qu’on connaît au final beaucoup mieux que la révolte elle-même, en raison des sources qui sont essentiellement issues des autorités coloniales. Cette campagne débute avec plusieurs échecs, notamment à Yankasso. Mais les renforts arrivent et avec eux, des officiers expérimentés : la révolte se transforme en terrible répression. Selon Thomas Vennes, au plus fort du conflit, on « rase un village par jour environ ». Beaucoup d’habitants, retranchés dans leurs « soukalas », résidences qui ont l’apparence de fortins, sont tués par les tirs d’artillerie. D’autres sont mitraillés lorsqu’ils essaient de s’enfuir, notamment à Bagassi en mai 1916.
Même pour les autorités coloniales, ces tactiques apparaissent bientôt trop violentes et inefficaces. Le massacre systématique est donc éventuellement remplacé par la « théorie de la tache d’huile », qui vise à obtenir la collaboration de la population.
À la fin de la révolte, il n’est pas aisé d’identifier les responsables : les différentes composantes de l’autorité coloniale se renvoient la balle. Le pouvoir civil affirme que la révolte a été déclenchée par le recrutement forcé visant à garnir les rangs des unités de tirailleurs sénégalais, les militaires par l’échec de l’intégration. Thomas Vennes fait toutefois remarquer que les deux administrations, civile et militaire, ont eu recours à la violence. De plus, le climat de l’époque, marqué entre autres par la peur d’une infiltration allemande dans les colonies, a poussé les gouvernements de la région à accélérer le rythme des exactions.
Sans surprise, la plupart des procès qui ont suivi la guerre du Bani-Volta n’ont pas mené à grand-chose. La plupart des accusés furent blanchis. Cette guerre fut ensuite « oubliée »... d’un oubli volontaire. Redécouverte seulement à partir des années 1990, on commence à peine aujourd’hui à comprendre l’importance, pour la population locale, de sa signification historique.