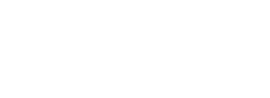Histoire du territoire
De la dernière glaciation à aujourd'hui : petite histoire du territoire lavallois
Géographie et géologie
L’histoire de Laval a commencé bien avant la colonisation française. L’île a émergé au moment de la disparition de la Mer de Champlain il y a environ 8500 ans, après la fin de la dernière glaciation. Ce n’est alors qu’un archipel, et il faudra attendre plusieurs siècles encore, et plus précisément l’époque surnommée le « stade de Saint-Barthélémy », pour que l’île prenne à peu près l’apparence qu’elle a aujourd’hui. Entretemps, le mouvement de l’eau a déposé du limon un peu partout sur la future île Jésus, donnant à son sol sa composition actuelle.
Une présence autochtone soutenue
Les premières traces archéologiques nous permettent de supposer que c’est une population de la culture de l’Archaïque laurentien qui aurait accosté la première à Laval. Un site fouillé en 1963 et situé sur la pointe nord-est de l’île Jésus contenait notamment une pointe de style « Lamoka » datant peut-être de plus de 3000 ans. D’autres artefacts, parmi les plus anciens trouvés directement sur le territoire lavallois, dateraient plutôt de l’époque du Sylvicole Moyen (2400 à 1000 AA), qui est notamment marquée par un essor de la poterie. Mais il est tout à fait possible que la présence autochtone remonte à beaucoup plus loin, les alentours étant déjà habités depuis plusieurs millénaires. Quelques sites paléo-indiens de la culture « Plano » ont par exemple été découverts jusque sur la Côte-Nord, au Québec : ils auraient plus ou moins 8 000 ans. Le temps et le travail des archéologues nous permettront peut-être un jour de confirmer leur présence à Laval.
Quand les Français visitent la région pour la première fois, au milieu du XVIe siècle, Montréal connaît une occupation iroquoienne semi-sédentaire : une civilisation y fleurit, et ses villages peuvent compter plusieurs centaines, voire milliers d’habitants. Aucun témoignage semblable à celui de Jacques Cartier ne nous permet de confirmer une pareille présence sur l’île Jésus, même si certains de ses sites sont particulièrement favorables aux établissements de type iroquoien. Mais à la fin du XVIIe siècle, quand le père Antoine Dalmas remonte la rivière des Prairies dans l’objectif de la cartographier, il identifie toujours des « cabanages algonquins » dans l’Ouest de l’île. De fait, même si l’île n’est pas occupée à temps plein, c’est un territoire où s’arrêtent de nombreux Autochtones, notamment pour chasser.
L’objectif premier de Dalmas n’est pas de renverser totalement cet état de fait. Sa mission consiste à chercher, sur les rives de la Rivière des Prairies, l’endroit idéal pour y installer une mission amérindienne. Insatisfait de la qualité du sol aux endroits où il débarque, incertain de ce qu’on trouvera au cœur des terres de l’île, ses conclusions sont sans équivoque : l’endroit n’est pas propice à l’établissement d’une telle mission. L’arrivée des Français ne signifie pas la fin de la présence autochtone sur l’île. Ils sont très peu nombreux à résider sur l’île au XIXe siècle (dans le recensement de 1881, on n’en compte plus qu’un seul!) mais ils y séjournent toujours. Au début du XXe siècle, de jeunes orphelines Kanien'kehá:ka (mohawks) vivent chez les Sœurs du Bon-Pasteur. D’autres Autochtones de Kahnawake vendent également de l’artisanat à l’Abord-à-Plouffe.
Balbutiements de la colonisation française
Il faut attendre la toute fin du XVIIe siècle pour que des colons français s’installent finalement sur la pointe Est de l’île Jésus, dans ce qui allait devenir, quelques années plus tard (en 1702), la première paroisse catholique : Saint-François-de-Sales. Le territoire de l’île est alors entièrement, ou presque, occupé par la forêt. Si la région, malgré son climat favorable – le temps y est plus doux que dans les seigneuries de la région de Québec – n’est peuplée que tardivement par les Français, c’est entre autres en raison de la menace iroquoise : la confédération y mène des raids. L’histoire canadienne conserve un souvenir vif de ce qu’elle a appelé le « massacre de Lachine », mais rappelons qu’une tragédie semblable, mais à plus petite échelle, a mis une halte temporaire au peuplement de la nouvelle paroisse. Entre 1692 et 1698, la population coloniale totale de l’île Jésus passe de 49 à seulement 13.
La Grande Paix de 1701 permet cependant aux colons de s’établir en territoire autrefois hostile. Et les autorités françaises en profitent : les terres sont concédées assez rapidement, et le défrichage qui suit devait changer à jamais le paysage lavallois.
La forêt est exploitée pour son bois et défrichée pour faire place à des terres agricoles. Mais elle a d’autres vertus économiques. Au début du XVIIIe siècle, le ginseng à quatre folioles est encore très présent dans la vallée du Saint-Laurent, et il s’exporte à prix fort jusqu’en Extrême-Orient. L’exploitation abusive de cette ressource cause bientôt sa quasi-disparition des écosystèmes de Nouvelle-France.
Un important couvert forestier subsiste encore, même après la concession des terres du bout de l’île à Joseph Fortier en 1746. Comme partout ailleurs dans la colonie, il représente une ressource importante autant qu’un obstacle aux activités agricoles.
La Conquête et ses suites
Dans les années de la guerre de Sept ans, et dans ses suites immédiates, toute la grande région de Montréal subit une pression intense. Ce n’est pas sans conséquences pour l’île Jésus. À l’époque, des marchands se sont installés sur l’île Jésus et y brassent de très bonnes affaires. Et si l’explosion soudaine du prix du blé peut bénéficier à certains opportunistes en temps de guerre, le dépeuplement général et l’exil mettent le commerce en péril. Quelques familles prospères, comme celle de Charles Rhéaume, recommencent donc à fréquenter Montréal, voire y déménagent, ou changent de négoce.
Le transfert d’administration ne provoque pas de bouleversement immédiat. Les Jésuites restent les seigneurs de l’île Jésus et quelques années après le départ de la France, la croissance démographique reprend de plus belle. L’île passe de 742 habitants en 1739 à 2385 en 1765, puis à 4653 en 1790. Le changement est donc graduel : les paroisses se densifient et de plus en plus de territoire est déboisé.
Au XIXe siècle, la proximité de Montréal et de son marché devient un facteur de peuplement beaucoup plus important que l’accroissement naturel des plus vieilles paroisses. Les atouts de Saint-François ne sont plus d’une importance critique, et son développement urbain prend un retard considérable. Le centre de l’administration lavalloise a lui-même changé depuis plusieurs décennies : une bonne partie de l’activité orbite maintenant autour de la paroisse de Saint-Martin, au centre de laquelle se situe notamment le Moulin du Crochet, manoir seigneurial à partir de 1803. En 1823, Saint-Martin est d’ailleurs la paroisse la plus peuplée de l’île Jésus, avec 2 606 habitants. Sainte-Rose arrive également devant Saint-François-de-Sales, avec 2 183 habitants.
Le régime anglais est friand du bois canadien : surtout pendant le blocus continental de Napoléon, qui défend l’accès des forêts européennes à l’Empire britannique! Le changement de « loyauté » aura donc à moyen terme un effet sur certaines industries canadiennes. Et malgré la défaite du « petit caporal », le bois continue d’affluer. Or, le passage des « cages », imposants assemblages de rondins, se fait sur la Rivière-des-Prairies et fait halte à L’Abord-à-Plouffe. Les « cageux », qui manœuvrent ces embarcations, fréquentent les auberges des environs, et font du village naissant un lieu de passage presque légendaire.
Révolution industrielle, ponts, carrières et chemins de fer
Durant la première moitié du XIXe siècle, l’accès à l’île Jésus est déjà garanti par plusieurs ponts. À plusieurs endroits, la glace hivernale et différents types d’embarcations sont cependant toujours privilégiés.
En bordure des ponts, le développement s’accélère. Le marché montréalais, après la construction de certaines structures (dont le Pont Viau, par exemple, à la fin des années 1850), devient soudainement plus accessible aux cultivateurs. Cela a une conséquence inattendue sur le paysage : comme il est désormais plus facile d’écouler la marchandise sur l’île de Montréal, plusieurs cultivateurs adoptent la culture maraîchère. Les effets de cette transition sont multiples : l’activité de moulins, comme celui du Crochet, qui est situé près du Pont Viau, décline, car elle est en partie – mais pas totalement – nourrie par la culture céréalière et les cargaisons de laine brute (il y a près de 7 000 moutons sur l’île Jésus en 1852, contre 87 en 1931). La loi seigneuriale, qui forçait plus tôt les habitants à utiliser le moulin banal, s’est également effritée et est finalement abolie en 1854.
Et si Laval reste essentiellement rurale, la fin du XIXe siècle voit un accroissement significatif de sa population ouvrière. Les industries légères ne sont pas les seules à les employer. Le développement de machineries lourdes permet l’exploitation plus rapide des carrières. Et il ne faut pas négliger leur importance sur l’histoire du territoire : l’île en porte depuis des traces indélébiles, et leur activité prolongée a provoqué d’importants débats jusque dans les années soixante.
Le chemin de fer est un des coups d’envoi de l’urbanisation contemporaine de l’île Jésus. Déjà, au début du XXe siècle, il permet à des travailleurs de Montréal de s’établir aux alentours de Parc Laval, l’ancien nom de Laval-des-Rapides, et de conserver leur emploi dans la métropole. Montréal est elle-même en pleine mutation : la population ouvrière s’éloigne déjà du centre, si bien que certaines œuvres sociales du Vieux-Montréal, comme la salle d’asile Saint-Joseph, doivent fermer faute de clientèle.
Habitants saisonniers et tourisme
Alors que l’industrialisation se poursuit à Montréal, l’île Jésus, et surtout ses magnifiques rives, séduisent de plus en plus de grandes fortunes. C’est le cas de Hugh Paton, qui construit un immense manoir sur une île qui conserve encore aujourd’hui son nom.
De véritables quartiers d’habitations saisonnières se constituent au début du XXe siècle. C’est notamment le cas de Laval-Ouest. Mais les plaisanciers s’installent un peu partout. Laval-des-Rapides connaît son lot de résidents montréalais célèbres : parmi eux, le maire Médéric Martin. Les « Boating Clubs », notamment celui de Saine-Rose, s’imposent également peu à peu. Et au milieu du siècle, les attractions de Laval ne sont plus réservées à la bourgeoisie exilée. De célèbres institutions, comme La Plage Idéale à Sainte-Rose, attirent de plus en plus la classe moyenne.
Laval, ville contemporaine
Nous pourrions consacrer des centaines de pages au développement contemporain de Laval, et qui en a fait le lieu de vie de plusieurs centaines de milliers d’habitants. L’automobile et l’accès facile à la propriété sont les moteurs principaux de cette explosion démographique. En 1930, il y a un peu plus d’un million de voitures en circulation au Canada ; la crise ralentit les ventes mais les « Trente Glorieuses » en généralisent presque l’utilisation. Auparavant, il était possible de travailler à Montréal et de vivre à Laval ; dans les années 50, cette perspective devient carrément séduisante.
Ce développement rapide ne fut pas sans frictions, ni sans inquiétude de la part des habitants de longue date : on retrouve des traces de ces tensions dans les journaux des années cinquante. Le territoire change au même rythme que le mode de vie : les terres agricoles font place à des quartiers résidentiels, souvent planifiés des années à l’avance. Les grands boulevards et autoroutes s’imposent à cette époque et fragmentent le territoire : ils deviennent presque de fait des frontières aussi importantes que les rivières.
La fusion de 1965 permet des transformations supplémentaires. Cette fusion n’était pas la reconnaissance d’un état de fait : chaque municipalité avait sa propre personnalité et le changement rencontre certaines oppositions. Mais celui-ci a encouragé la centralisation des efforts. Au début des années soixante, toute l’île Jésus ne comptait qu’un seul véritable hôpital : celui de Sainte-Rose, un établissement de quelques dizaines de lits à peine. Dans les années 70, la Cité de la Santé vient tout chambouler. On parle également déjà de l'aménagement d'un véritable « centre-ville » dès les premières années de l'existence de la ville fusionnée.
Ce n’est pas seulement le paysage qui change avec ce genre de grands projets. Le mode de vie aussi. Laval n’est plus seulement une « banlieue-dortoir » : elle redevient le principal pôle d’activités économiques et de services pour une bonne partie de sa population.